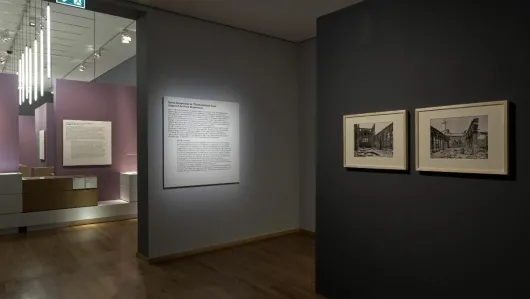Description
Croix processionnelle
PLUS D’INFORMATIONS SUR L’OEUVRE
Bibliographie
Marielle Martiniani-Reber (dir.), Byzance en Suisse, catalogue d'exposition, Genève, Musée Rath, Genève, du 4 décembre 2015 au 13 mars 2016, Milan, 2015, p. 315, n° 357
Marielle Martiniani-Reber (dir.), Antiquités paléochrétiennes et byzantines, IIIe-XIVe siècles, Collections du Musée d'art et d'histoire, Genève, Milan 2011, p. 64-66, n° 27
Byzanz Pracht und Alltag, [Exposition, Bonn, Kunst und Austellunghalle des Bunderespublik, 26 février-13 juin 2010], Münich, Hirmer, 2010, p.157, fig. 33
de Castro Valdès César Garcia (ed.), Signvm Salvtis Cruces de Orfebreria de los Siglos V al XII, KRK ediciones, 2008, pp. 326-329, n° 62
Cäsar Menz, Musée d'art et d'histoire, Genève, Genève/Zurich, Banque Paribas (Suisse), Institut suisse pour l'étude de l'art, 2008, p. 54, fig. 59
Schweizer François, Nielle byzantin : étude de son évolution, Genava, n.s., t. 41, 1993, p. 67-82, p. 69, repr. n/b, n° 1
Schweizer François, "L'art du niellage à l'époque byzantine", Musées de Genève, n° 321, novembre-décembre 1992. p. 10-13, p. 10 repr. coul.
Bank Alice, "Einige Besonderheiten in der Entwicklung der byzantinisichen Metallkunst", dans Metallkunst von der Spätantike bis zum ausgehenden Mittelalter, Berlin, 1982, p. 10-12; ill.1 et 2
Miroslav Lazovic, Nicolas Dürr, Harold Durand, Claude Houriet, François Schweizer, "Objets byzantins de la collection du Musée d'art et d'histoire", Genava, n.s., t. 25(1977), p. 5-62, p. 27-30, p. 38-46, fig. 18 et fig. 24, n° 16
Expositions
Cette œuvre figure dans la publication MAH
Autour des métiers du luxe à Byzance
Autour des métiers du luxe à Byzance
Le colloque "Autour des métiers du luxe à Byzance" a été organisé à l’occasion de l’exposition "Byzance en Suisse", qui s'articulait en bonne partie autour du "Livre du Préfet" (règlement des professions à Constantinople au début du dixième siècle).
De nombreux spécialistes suisses et internationaux y ont abordé les thématiques suivantes: les objets de luxe qui nous sont parvenus, ceux présents dans la littérature et dans l’iconographie, les échanges diplomatiques, la réglementation des professions du luxe, le travail de l’orfèvrerie et de la soie, ainsi que le mode de vie de la cour et de l’aristocratie.
Cette publication a été réalisée avec le soutien de la Fondation Migore